Big data : où en sont les entreprises françaises ?
(Big) data : où en sont les entreprises françaises ? Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ?
Avant-propos (Big) data : difficile d’échapper à cette déferlante depuis quelques années et, avec elle, au flot de théories, analyses et commentaires sur ses promesses en termes d’efficacité, de performance et d’opportunités de développement de nouvelles offres et services ciblés. Si tout le monde semble s’être emparé du sujet, des plus sceptiques, qui y voient une nouvelle bulle prête à faire « pschitt », à ceux pour qui il s’agit d’un véritable big bang — du même ordre que les précédentes révolutions industrielles — force est de constater qu’à ce jour, la révolution Big data ne s’est guère propagée au-delà des modèles économiques des grands acteurs globaux du digital. Les résultats de cette enquête, menée auprès de plus de 150 entreprises françaises, révèlent qu’en dépit d’une perception majoritairement positive, le « Big data bang » n’a pas encore eu lieu dans la réalité. C’est ce que nous enseigne le passage au scanner de notre Indice EY de Maturité Data, spécialement conçu dans le cadre de cette étude : seule une minorité d’entreprises peut se targuer d’une maturité élevée dans son exploitation de la data, tandis que la majorité adopte une posture attentiste, sans véritablement savoir par quel bout prendre un concept devenu flou. Si ce retard s’explique par dix principaux freins d’ordre psychologique, stratégique, organisationnel ou technologique, que nous avons identifiés tout au long de la chaîne de valeur de l’exploitation (Big) data — de la collecte à la sécurité et la protection des données, en passant par l’analyse et la stratégie globale de l’entreprise — il peut toutefois être rattrapé si l’exploitation (Big) data est intégrée dans une stratégie et une vision globales. En effet, l'exploitation (Big) data n'est pas tant un problème technique qu'un sujet de transformation des organisations et de leurs modèles économiques. Elle relève de la capacité à convertir la data en connaissances, en innovation et en valeur pour les organisations. Bruno Perrin David Naïm Associé Associé Ernst & Young et Associés Ernst & Young Advisory Responsable du secteur Responsable du pôle Technologies, Médias, Télécoms Stratégie, Marketing et Innovation (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
Sommaire Quelques enjeux chiffrés de la (Big) data 4 I/ Les entreprises françaises à l'épreuve de l'Indice EY de Maturité Data 6 Exploitation de la data : quelle maturité pour les entreprises françaises ? 7 Palmarès des secteurs les plus matures 8 II/ Exploitation de la (Big) data : 10 freins identifiés 12 La collecte de données clients encore sous-exploitée 13 Le traitement et l'analyse des données clients : des capacités inadaptées 15 La data non perçue comme un support aux décisions stratégiques 22 Vie privée et sécurité : des enjeux encore sous-estimés 24 III/ Déployer une stratégie (Big) data efficace : les leviers d'action 26 La révolution (Big) data n’a pas encore eu lieu 27 Stratégie (Big) data : deux approches coexistent actuellement 29 Facteurs clés de succès du déploiement d’une stratégie (Big) data 30 Exploitation (Big) data : des freins aux leviers d'action 34 Études de cas 36 Note méthodologique 42 Abréviations 42 Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 3
Quelques enjeux chiffrés de la (Big) data Big data FREIN 6 43 % 18 % des entreprises ont étudié des entreprises ont des plans d'action l'opportunité Big data Big data en cours de déploiement FREIN 1 FREIN 2 Collecte de la data Analyse de la data Limitée aux canaux traditionnels Données non structurées, le maillon faible 45 %2 45 % des entreprises des entreprises estiment collectent des données leurs données clients insuffisamment 3 analysées/exploitées texte non structurées FREIN 9 FREIN 10 Protection et sécurisation de la data Triple enjeu de confiance, de fiabilité et de réputation 30 % 70 % 59 % 6 des entreprises ne se sentent pas des consommateurs des entreprises estiment concernées par les enjeux de vie sont réticents à partager que les menaces externes privée (privacy) leurs données personnelles sur les Systèmes d'information sont en hausse Transversalité et implication de la direction générale : des impératifs FREIN 7 FREIN 8 tout au long du cycle de la data 4 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
S our 1 c Indice EY de Maturité Data e : E 17 % Y 18 % des entreprises ont des plans d'action d'entreprises « très matures » Big data en cours de déploiement dans l'exploitation des données clients FREIN 3 FREIN 4 Traitement et exploitation de la data Manque de compétences analytiques Carence des outils de traitement des données non structurées moins de 10 27 % 5 des entreprises ont mis en place des outils/ profils data process pour fiabiliser/exploiter par entreprise les données non structurées FREIN 6 FREIN 5 ROI des projets data Utilisation de la data L'absence de mesure du ROI peine Analyse de la data (trop) peu orientée à déclencher les investissements vers le temps réel et le prédictif 58 % 10 % des entreprises n'ont pas cherché des entreprises font à quantifier le ROI des investissements de l'analyse prédictive Big data 1 Cf. note méthodologique p.42 2 Ce pourcentage monte à 79 % si on intègre les données issues des images ou vidéos et à 84 % si on intègre les données sonores (enregistrements vocaux, musique, etc.) 3 Données non structurées : informations et contenus en provenance des emails, SMS, logs, avis clients, réseaux sociaux, vidéos, etc. 4 Data miner, data manager, data scientist, etc. 5 Pour 70 % de notre panel d'entreprises (cf. note méthodologique p.42) 6 Entreprises interrogées dans l'étude EY mondiale "Under cyber Attack - EY's Global Information Security Survey 2013" Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 5
I/ Les entreprises françaises à l'épreuve de l'Indice EY de Maturité Data 6 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
Après la compétition entre les réseaux (Télécoms et Technologies) et les contenus (Médias), la bataille s'articule désormais autour de la data et s'étend à l'ensemble des détenteurs de données (publiques ou privées). Bruno Perrin Associé - Ernst & Young et Associés - Responsable du secteur Technologies, Médias, Télécoms Exploitation de la data : quelle maturité pour les entreprises françaises ? Afin de mesurer l’avancement des entreprises en matière L’Indice EY de Maturité Data a révélé que les entreprises les d’exploitation de leurs données clients, EY a construit l’Indice plus matures en matière d’exploitation des données clients se de Maturité Data. • En savoir plus p. 42 distinguent par les critères suivants : Cet indice agrège des comportements et faits constatés • Anticipation des enjeux stratégiques liés à une meilleure auprès des entreprises interrogées, et non leurs déclarations utilisation des données internes et externes ; d'intention. Le passage au révélateur de cet indice de • Diversité des données collectées et des canaux de collecte maturité établit un fort décalage entre le « buzz » que génère • Constitution d’équipes de data scientists et autres experts le concept flou du Big data et la réalité de la maturité des data : grandes entreprises. • Adoption de nouvelles technologies d’exploitation de la Certes, les entreprises françaises utilisent bien la data pour data ; mesurer et comprendre leur activité et l’environnement • Prise en compte des enjeux de protection de la vie privée dans lequel elles évoluent, mais cette exploitation de la et des données à caractère personnel (privacy) dans data est encore loin d’être systématique en ce qui concerne l’exploitation des données clients ; l’analyse fine des comportements de leurs consommateurs • Anticipation du risque réputationnel. et les corrélations sous-jacentes, et encore moins en matière d’anticipation et de prédiction. Indice EY de Maturité Data des entreprises Parmi les entreprises « très matures » Non matures Transports Grande consommation 9 % Très matures et distribution 56 % 20 % 17 % 42 % 27 % Autres 29 % secteurs Peu matures TMT* * Technologies, Médias, Télécoms Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 7
Palmarès des secteurs les plus matures Les deux secteurs les plus matures dans l’exploitation de la data sont les TMT (Technologies, Médias, Télécoms) ainsi que celui de la distribution et des produits de grande consommation. Un résultat guère surprenant dans des industries où la data est le pilier historique de la connaissance client et des stratégies de segmentation marketing associées. Secteur des TMT Le secteur des TMT est caractérisé par la quantité • Stratégie (Big) data colossale (amplifiée avec l’Internet des objets/ Pour les entreprises de réseaux notamment, objets connectés) de data disponibles dans les l’exploitation de la data permet une optimisation systèmes d’information. inédite du business (possibilité de prévenir les • Collecte des données défaillances réseaux, interruptions de services, résiliations d’abonnement…), le développement En matière de remontée des données issues des de « services intelligents » et la valorisation de réseaux sociaux ou de l’open data, les TMT sont en données auprès de tiers. Sur ce dernier point, à deuxième position derrière la grande distribution. titre d’exemple, les trois plus grands opérateurs Elles représentent le tiers des entreprises du panel de télécoms de Grande-Bretagne ont constitué collectant des données sociales et le quart de une société commune, Weve, pour vendre à celles ayant recours à l’open data. des annonceurs les données (anonymisées) de leurs clients (données d’achat, données de géolocalisation, données Internet…). 8 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
Dans les médias, les modèles analytiques à visée prédictive • Outils et ressources sont déjà largement utilisés. Les recommandations de sites C’est dans la grande distribution que les ressources humaines d’achats de biens et services culturels en ligne, tels que Netflix et informatiques (logiciels statistiques, solutions de ou Amazon, reposent sur des modèles capables de prévoir ce visualisation) dédiées à l’analyse des données sont les plus qu’un individu serait en mesure d’apprécier au regard de ses nombreuses. La moitié des entreprises du panel EY déclarant achats antérieurs, mais aussi d’achats similaires effectués par avoir recruté des experts data (data manager, data miner ou d’autres consommateurs, afin de lui proposer des produits en data scientist) appartient au secteur de la grande distribution. conséquence. Ces sites sont emblématiques de la capacité à formuler des recommandations pertinentes à des audiences/ • Stratégie (Big) data cibles potentielles sur la base d’une analyse poussée de la « L’amélioration de la performance commerciale » est la data. première raison invoquée par les entreprises du secteur, suivie • Protection et sécurité de très près par « l'amélioration de la connaissance client ». En effet, la data est précieuse pour nouer une relation Les TMT sont au même niveau de maturité que la grande d’engagement avec le client final, être en mesure de multiplier distribution pour la mise place des process internes de les points de contact et les occasions de recommandation tout fiabilisation des données non structurées, soit le tiers des au long de son parcours multi/cross-canal. Cela permet de lui entreprises concernées. Les TMT constituent la deuxième soumettre la bonne offre, au bon moment et au bon endroit industrie la plus mature en termes de sensibilisation aux (géolocalisation) et, au-delà, élaborer des modèles prédictifs aspects de privacy. qui visent à garder une longueur d’avance. C’est d’ailleurs la première attente relative à la mise en place d’une stratégie (Big) data dans le secteur de la distribution et des produits de Secteur de la distribution et des produits de grande consommation. grande consommation • Protection et sécurité Dans le secteur de la grande distribution, l’exploitation La grande distribution est le secteur le plus mature en (Big) data répond à trois enjeux opérationnels majeurs : la termes de mise en place des process internes de fiabilisation relation d’engagement avec le client final, la performance des données non structurées, soit le tiers des entreprises opérationnelle et la qualité et la cohérence des données concernées. C’est aussi l’industrie où la sensibilisation aux remontées par l’ensemble des entités du groupe (franchises et aspects de privacy est la plus affirmée : une entreprise autres filiales). sur trois considérant qu’il existe des enjeux de vie privée • Collecte des données dans l’exploitation de la data appartient au secteur de la Les entreprises du secteur de la grande distribution sont distribution et des produits de grande consommation. celles qui remontent davantage de données des réseaux sociaux (plus du tiers des entreprises concernées), éléments clés pour connaître les parcours clients. Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 9
Exploitation de la (Big) data : des opportunités à saisir pour tous les secteurs d'activité Secteur des transports Avec la constitution de communautés où le partage Le Big data est le nouveau carburant de la voiture de données s'organise, le comportement du voyageur connectée, et demain autonome, qu’il s’agisse de son — qui a aujourd'hui un mode de consommation nomade insertion dans un système de mobilité intermodal, de et mobile — est désormais tracé en temps réel pour lui services facturés à l’usage (ex. : assurance), de la permettre de trouver le service répondant à ses besoins surveillance de son fonctionnement en continu ou du à l'endroit où il se trouve grâce à une analyse prédictive renforcement de la relation directe entre constructeurs de ses déplacements. et utilisateurs. Christine Vitrac Jean-François Bélorgey Associée - Ernst & Young et Associés - Responsable du secteur Transport en France Associé - Ernst & Young et Associés - Responsable du secteur Automobile en France Secteur de la distribution et des produits de grande consommation Très tôt, les secteurs Retail & Consumer Products ont développé une forte culture de la donnée client : la distribution via la fidélisation, les industriels via les études marketing, les panels, le géomarketing, les analyses sensorielles. Les pure players du e-commerce sont par ailleurs à l’origine des avancées les plus significatives dans le domaine de l’exploitation business des données clients, en parvenant à créer les nouveaux standards d’excellence de l’expérience client grâce à des ciblages très personnalisés, des moteurs de recommandations, ou encore des mécaniques de promotions très élaborées. Le Big data représente à ce titre un véritable défi pour les acteurs plus traditionnels, auquel s’ajoute celui de la sécurité et de la protection des données personnelles, fondements de la confiance du consommateur. David Naïm Associé - Ernst & Young Advisory - Responsable du pôle Stratégie, Marketing et Innovation Secteur de l’énergie et des utilities Le secteur de l’énergie est à l’aube d’une profonde mutation portée par la data, avec en particulier le déploiement programmé des compteurs intelligents. Le Big data est un des leviers majeurs qui permet de rendre les réseaux plus intelligents et plus sûrs, et cela au moindre coût, tout en répondant aux enjeux de la transition énergétique. Les données sont un élément stratégique pour assurer une meilleure maîtrise de la demande d’énergie (eau, gaz, électricité) tant à l’échelle nationale que locale (smart cities), mais aussi ouvrir plus largement le marché et enfin accompagner l’émergence de nouveaux usages. Mohamed Larabi Associé - Ernst & Young Advisory 1010 || (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
Secteur des services financiers – le marché de l’assurance Big data et enjeux de l’assurance connectée Le traitement de données massives et la construction d’indicateurs multiples sont au cœur même du métier d’assureur et ont pour objectif de comprendre et d’évaluer les risques pour générer des souscriptions. Nos clients des services financiers ont conscience que la capacité à exploiter et protéger ces données (données internes combinées aux données issues des réseaux sociaux, des déclarations de sinistres, des centres d’appel, des suivis de campagnes marketing, des agrégateurs de données web, des données personnelles [anonymisées], de l’open data, etc.) est clé pour relever les nouveaux défis qui se posent à leur métier et leur organisation : • De la maîtrise à la prévention des risques (ex. : fraude) grâce aux modèles prédictifs • Une connaissance précise des habitudes des clients « connectés » (alimentaires, sportives, professionnelles, culturelles…) — qui s’avérera plus efficace que les questionnaires de santé — pour une relation de proximité et de conseil. Cette meilleure connaissance permettra de développer de nouvelles méthodes de segmentation et de tarification, d'optimiser le nombre de produits d’assurance par client, mais aussi un meilleur retour sur investissement des politiques commerciales (campagnes publicitaires, démarchage commercial, messages de prévention « ciblés ») • L’optimisation de l’allocation du capital • La confiance des clients au regard de l’utilisation de leurs données personnelles, vecteur de la réputation de l’établissement. Pierre Borg Directeur exécutif - Ernst & Young Advisory Secteur des sciences de la vie Le Big data génère de formidables opportunités tout au long de la chaîne de valeur de la santé Dans un contexte marqué par le « patent cliff » et la réduction des dépenses publiques de santé, auxquels s’ajoute le durcissement des normes de santé, la recherche et les essais cliniques, peuvent être optimisés grâce à une analyse de données plus efficace. La consommation de médicaments et les approvisionnements associés peuvent être calculés en temps réel et en prédictif en combinant des données internes et externes. Les efforts commerciaux et marketing peuvent être alignés en temps réel grâce à de meilleurs outils de reporting et d’analyse des attentes des patients (ex. : en écoutant les médias sociaux). L’industrie des sciences de la vie est alors amenée à réinventer son modèle économique en prenant part à la coordination d’un parcours de soin centré sur le patient, avec à la clé la création de nouvelles filières d’excellence, sources de croissance pour l’avenir (ex. : monitoring ou visites médicales à distance), et cela afin d’apporter une réponse de plus en plus individuelle aux patients, mais aussi aux professionnels de santé, aux clients et aux payeurs. Cédric Foray Associé - Ernst & Young Advisory Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? || 1111
II/ Exploitation de la (Big) data : 10 freins identifiés 12 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
La collecte de données clients : les canaux digitaux sous-exploités Frein n° 1 - La collecte de la data encore Les canaux de collecte utilisés selon la maturité largement limitée aux canaux traditionnels des entreprises Les données collectées par les entreprises pour renforcer leur Marketing digital connaissance client et déployer des stratégie marketing en 96 % conséquence proviennent très majoritairement des systèmes 44 % traditionnels de facturation pour 84 % des entreprises de Espace client Internet notre panel, et d’outils CRM pour 66 %. 92 % Un constat d’autant plus surprenant que les données non 68 % structurées constituent, à l'ère digitale, la plus grande partie Système de facturation des données émises et partagées à travers le monde. Chaque 92 % minute, 208 300 photos sont publiées sur Facebook et 84 % * CRM 350 000 tweets sont postés . Au-delà des espaces clients Internet dédiés, les entreprises 85 % utilisent encore peu les canaux digitaux et mobiles pour 53 % capter des données sur leurs clients. La part des entreprises Réseaux sociaux ayant recours aux réseaux sociaux, aux capteurs intégrés 69 % dans les équipements clients et aux données GPS sur la 25 % localisation et les déplacements clients s'élève respectivement Portail Internet 58 % à 36 %, 14 % et 11 %. 33 % Ces canaux ont pourtant la spécificité de fournir des Open data informations qualitatives, contextuelles et en temps réel 28 % sur le comportement des clients, ce qui est précieux pour 24 % comprendre leur expérience et leur parcours, contextualiser Capteurs intégrés leurs achats et, in fine, qualifier leur profil. 23 % À ce jour, ce sont très majoritairement les entreprises de la 8 % grande distribution et du secteur des TMT qui ont recours aux Géolocalisation canaux digitaux et mobiles. 12 % 6 % Entreprises « très matures » Entreprises « non matures » * "Ready for take off? Overcoming the practical and legal difficulties in identifying and realizing the value of data", EY, 2014 Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 13
Frein n° 2 - Les données non structurées, Les données non structurées sont très peu exploitées le maillon faible de l'analyse 45 % Au-delà des traditionnelles données textes structurées sur des entreprises interrogées collectent des données non leurs clients — coordonnées, comportements et dépenses — structurées collectées par 90 % des entreprises de notre panel, celles-ci collectent aussi des données non structurées. 27 % 45 % des entreprises interrogées collectent des données des entreprises interrogées sont outillées pour fiabiliser ces * textes non structurées : verbatims sur des espaces clients données Internet ou remontés de points de vente, conversations Moins de 10 % numériques, avis soumis ou partagés en ligne, données sonores, images et vidéos. Si la moitié des entreprises les plus des entreprises disposent de logiciels de statistique matures dispose de ce type de données sur leurs clients, elles prédictive ne sont que 10 % parmi les sociétés « non matures ». Moins de 10 data experts/entreprise Ce sont majoritairement les secteurs de la grande distribution pour traiter les données non structurées** et des TMT qui collectent ce type de données. Les proportions tombent respectivement à 16 % et 21 % pour les données sonores (enregistrements vocaux, musique…) et Le directeur financier au cœur de les images ou vidéos (photos personnelles, films…). l'enjeu de structuration de la data 45 % des entreprises interrogées reconnaissent que les données collectées ne sont pas assez exploitées : 26 % Aujourd’hui principalement composée d’informations affirment collecter une grande quantité de données mais financières, l'information structurée comprendra ne pas toujours maximiser leur valeur et près de 20 % demain une part croissante d’informations RH, reconnaissent collecter des données mais les exploiter assez sociales, liées au parcours clients, à la consommation peu. énergétique, aux machines communicantes, aux blogs, Pourtant, l’amélioration de l’expérience client est l’axe etc. stratégique numéro un des entreprises que nous avons Le directeur financier est doté d'un savoir-faire interrogées (68 % ont répondu « tout à fait »), loin devant unique en termes de structuration de l’information, de la stratégie tarifaire (36 % ont répondu « tout à fait ») ou le fiabilisation, de production et d’analyse pour éclairer les développement à l’international (30 % des répondants). choix des actionnaires et du management. Aussi, ces compétences le mettent naturellement en première ligne dans les projets de transformation liés au (Big) data. Il aura pour défi notamment de faire parler les indicateurs financiers et non financiers, d’intégrer opérations et finance, de casser les silos organisationnels pour mieux capter le parcours client et enfin d'orienter l’entreprise vers l'élaboration de scénarii futurs. * Il existe des outils de business intelligence permettant de remonter les Pierrick Vaudour verbatims en temps réel sur une liste de sujets définis, Associé - Ernst & Young et Associés - Financial Accounting Advisory Services Dossier Big & smart data, Stratégies n° 1770, 22/05/2014 ** Pour 70 % des entreprises de notre panel 14 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
Le traitement et l'analyse des données clients : des capacités inadaptées Le Big data implique le traitement de données volumineuses (nombreuses sources d’historiques, bases de corrélations, etc.) en un temps raisonnable, voire en temps réel. Le problème n’est plus tant de stocker (a priori) un volume considérable de données clients, mais de sélectionner, dans le flux continu de data, celles que l’on va conserver (a posteriori) : un choix qui requiert des compétences et outils spécifiques. Bien souvent, une combinaison de méthodes statistiques classiques (statistiques descriptives, segmentation, scoring, etc.) et de solutions de calcul permet de résoudre ces difficultés. Par exemple, la parallélisation des calculs répète les mêmes calculs sur des groupes de données séparés, des séquences, avant de les réconcilier, afin qu’ils soient globalement effectués de manière plus rapide. Cette méthode de calcul est combinée avec des estimateurs statistiques pour converger vers une réponse la plus juste possible dans le délai imparti. Notons que les formes de statistiques descriptives auxquelles on aboutit aujourd’hui sont plus pures qu’à l’époque où l’on ne disposait que d’échantillons de données qu’il fallait extrapoler (du fait des coûts de récolte, de stockage et de traitement). Raison pour laquelle la quantité de données disponibles et leur traitement ne sont aujourd’hui plus une limite, ce qui permet de travailler sur des données plus exhaustives. Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 15
Frein n° 3 - Un manque de compétences Nombre de personnes dédiées à l'exploitation de la data analytiques Total panel : 152 entreprises Les entreprises ne disposent pas de profils et de compétences 50 ou plus analytiques en interne pour exploiter l’ensemble des données utiles à leur activité, traiter les données historiques en temps 6 % réel et relationnelles (réseaux, amis, familles, collègues), les 18 % contextualiser et en tirer des résultats utiles et exploitables. 10 à 49 Seules 30 % des entreprises interrogées ont recruté des profils spécifiques dédiés au traitement et à la gestion de la data. 70 % Plus généralement, pour 70 % des entreprises interrogées, moins de 10 l’ensemble des ressources dédiées au traitement des données clients représente moins de 10 personnes. Seules 6 % des entreprises du panel disposent d'effectifs dédiés à la data de plus de 50 personnes. 16 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
Entreprises ayant un effectif data de moins de 10 Entreprises ayant un effectif data de 50 personnes ou plus personnes 79 % 71 % 70 %* 39 % 3 % 4 % 16 % 6 %* Non matures Peu matures Très matures Non matures Peu matures Très matures * 70 % des entreprises du panel ont un effectif data * 6 % des entreprises du panel ont un effectif data inférieur à 10 personnes supérieur à 50 personnes Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 17
Frein n° 4 - Une carence des outils de traitement des données Individuelles, hétérogènes, multiples et éparses, les traces Les données issues du web, du mobile et des objets connectés numériques collectées en temps réel n’ont, prises isolément, ont rendu caduques les techniques d’analyse classique, aucune valeur. Leur valeur vient du sens qu’on arrive à en manquant désormais de puissance, de rapidité, de flexibilité, tirer, en termes de corrélation ou de prédictibilité. et devenues trop onéreuses. Il est possible de donner du sens à ces données en les Des technologies et outils de traitement, ainsi que des rattachant à leur cause commune : le comportement d’un compétences spécifiques sont nécessaires pour extraire des être humain. De cette façon, on peut non seulement espérer informations et enseignements des données non structurées, comprendre le comportement d’un individu à travers les le maillon faible de l’analyse. Il faut en effet les « traduire », traces qu’il laisse, mais aussi, in fine, recomposer son ADN les fiabiliser, les indexer, les combiner avec les données numérique. existantes, pour pouvoir les intégrer au reporting qui sera Au-delà de la collecte de données et de leur stockage, remonté au niveau décisionnel. l’intelligence algorithmique est indispensable pour donner un sens à la masse de données générées par chaque Enjeu de fiabilité et de sécurité individu et ses objets connectés. Cette intelligence de la data algorithmique vise à regrouper, confronter et mettre en relation des données issues de sources diverses pour créer et caractériser des groupes statistiques — sur la base de Les entreprises intègrent de plus en plus le Big tendances caractérisées — afin de décrypter et d’anticiper ses data dans leurs processus décisionnels. Il apparaît comportements dans des environnements différents. ainsi essentiel de veiller à la fiabilité et la sécurité des données analysées. Pour ce faire, les responsables Il faut donc contextualiser la donnée qui, seule, n’aura aucun sécurité ou les contrôleurs internes doivent sens, mais prendra toute sa valeur dans la mise en relation appréhender les processus Big data de manière globale avec une multitude d’autres données. C’est ce pouvoir de afin de déployer les dispositifs de sécurité et de contrôle contextualisation qui permettra à l’entreprise de proposer adéquats. Ces dispositifs doivent permettre de répondre la bonne offre à la bonne cible, au bon moment et au bon aux enjeux de volume, de vitesse de traitement, de endroit (ou via le bon canal*). diversité des formats et permettre une circulation intègre et sécurisée de l’information. Pascal Antonini Associé - Ernst & Young Advisory - IT Risk and Security * Comportements culturels et données personnelles au cœur du Big data : entre la nécessaire protection et une exploitation au service de nouveaux équilibres - EY, novembre 2013 18 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
La majorité des grandes entreprises a conscience de Les chiffres nous montrent que les techniques visuelles et la progression de ces données non structurées et de interactives de présentation des données se généralisent l’indispensable effort de fiabilisation. 59 % des entreprises au sein des entreprises. Pour n’en citer que quelques-unes : que nous avons interrogées affirment anticiper une hausse Qlikview est utilisée par 43 % des entreprises interrogées ; du volume de données à fiabiliser dans les 18 mois. En même Spotfire par 28 % ; 41 % Cognos et Business Object par 43 %. temps, seules 27 % d’entre elles affirment avoir mis en place En revanche, ces solutions sont surtout déployées au service des process internes pour fiabiliser ou exploiter les données de la compréhension et la restitution du passé, encore peu non structurées. comme outil d’analyse, et encore moins dans l’élaboration de Dernière étape pour rendre les données clients exploitables : scénarii prédictifs. la visualisation et la simplicité d’usage des résultats de l’analyse, décisives pour la compréhension et l’exploitation des résultats par les décideurs opérationnels. En effet, la façon de partager les données est essentielle pour que chaque métier puisse se les approprier et en tirer de la valeur. Une data visualisation de qualité donne aux décideurs le moyen de manipuler de larges volumes de données pour faire émerger des tendances, mettre en lumière des corrélations qui ne peuvent se révéler qu’avec la visualisation et répondre à des questions spécifiques. En somme, des résultats d’analyse restitués de façon visuelle, mis en perspective et hiérarchisant les enjeux. La data visualisation permet aussi d’assurer une communication, interne et externe, efficace et cohérente (la visualisation de données unifie le discours en le rendant accessible, clair et facile à partager). Il s'agit donc d'un moyen efficace de faire passer un message sans ambiguïté auprès de ses clients, actionnaires et autres parties prenantes. Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 19
Frein n° 5 - L’analyse de la data encore (trop) peu orientée vers le prédictif et le temps réel La prédictibilité des modèles analytiques et la capacité de Elles sont encore plus nombreuses (92 % des plus matures) prise de décision en temps réel constituent la vraie longueur à penser qu’une telle stratégie leur permettrait d'assurer la d’avance en matière d’exploitation des données clients. rapidité de leurs extractions et requêtes. Ces modèles à visée prédictive sont déjà utilisés, Dans l’industrie, et particulièrement les industries de réseaux notamment par les champions du numérique, à travers les et d’infrastructures (communications et énergie, mais aussi recommandations de sites d’achat de biens et services en transports et automobile), les solutions de maintenance ligne — sites d'e-commerce ou de vidéo à la demande — qui prédictive, en collectant et analysant des données en temps reposent sur des modèles capables de prévoir ce qu’un réel à partir de nombreuses sources (logs de maintenance, individu serait en mesure d’apprécier au regard de ses achats logs des performances, données de surveillance, données antérieurs, mais aussi d’achats similaires effectués par environnementales, données financières, etc.) contribuent d’autres consommateurs, afin de lui proposer des produits à améliorer significativement la qualité des prestations et la en conséquence. Au-delà de la corrélation avec le contexte, performance opérationnelle des entreprises. Elles permettent l’intelligence algorithmique vise à établir des liens de cause notamment de réaliser des diagnostics préventifs et, au-delà, à effet pour mieux prévoir les comportements futurs de de la maintenance prédictive. l’internaute. Il est alors possible de repérer en temps réel les schémas Seules 10 % des entreprises interrogées exploitent les propices à la détection préventive des incidents et pannes données clients à des fins prédictives et 5 % d’entre elles afin de déterminer les domaines les plus exposés au risque le font pour optimiser les process techniques permettant et d’identifier la cause première du problème. La maintenance d’accroître la rapidité d’exécution et d'augmenter les capacités dirige alors proactivement les ressources vers ces domaines de stockage (éléments clés pour exploiter des volumes avant que le risque ne devienne une réalité. En d’autres croissants et toujours plus rapides de données et de flux termes, il s’agit d’anticiper les problèmes réseaux plusieurs d’informations). semaines, voire plusieurs mois, à l’avance et d’éviter les Si elles n’ont pas les compétences requises, les entreprises les accidents, interventions et arrêts de production qui peuvent * plus matures de notre panel ont néanmoins été sensibilisées à se révéler très coûteux financièrement et en termes d’image . ce sujet : 73 % affirment que la mise en place d’une stratégie N'oublions pas que dans certaines industries, le coût de la (Big) data leur permettrait d’utiliser des modèles prédictifs en maintenance est bien supérieur à celui de l'investissement temps réel (contre 43 % pour les moins matures). initial. * Emmanuelle Delsol, dossier « Data le contrat de confiance », L’Usine nouvelle, N° 3372, 10/04/2014 « La maintenance prédictive au service de l’industrie », analysepredictive.fr, 23/08/2011, consulté le 25/06/2014 20 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 21
La data non perçue comme un support aux décisions stratégiques * Frein n° 6 - Le manque de transversalité Frein n° 7 - L’absence de mesure du ROI dans la gestion des projets (Big) data des projets (Big) data Le manque de transversalité dans l’organisation et la Le Big data marque un tournant majeur dans l’exploitation gestion des projets data est un frein à la valorisation des des données clients et représente un formidable levier de données clients. Les projets sont souvent perçus comme croissance et de profitabilité. Pourtant, les résultats de notre trop complexes, trop longs à mettre en œuvre et donc non enquête laissent entrevoir que la data peine à convaincre prioritaires. en termes de ROI. On constate une très faible prise de En outre, les silos en interne sont les principaux freins conscience, au sein des entreprises, de la valeur ajoutée des organisationnels à une optimisation de l’exploitation de la projets data. Il existe peu d'études de cas sur l’opportunité de data, même si les dirigeants le reconnaissent moins volontiers développer des projets (Big) data. Quantifier et mesurer la ** prédéfinis et d’une lorsqu’il s’agit de leur organisation. Même parmi les très valeur des projets data, sur la base de KPI matures (17 % du panel), 39 % considèrent qu’il s’agit encore estimation du retour sur investissement, permettrait pourtant d’un frein à l’exploitation de la data. d’établir une feuille de route avec des projets data à déployer prioritairement et d’obtenir le sponsorship du management. Preuve qu'il s'agit d'un frein quel que soit le niveau de À ce jour, seules 29 % des entreprises interrogées considèrent maturité data des entreprises, 39 % de celles de notre panel que le Big data marque un tournant majeur et représente reconnaissent que les silos internes demeurent un frein à un levier de croissance. Quant à la mise en place d’un « plan l'exploitation optimale des données clients. d’action Big data avec des initiatives concrètes », elles ne sont Chaque métier ayant pour habitude d’utiliser et de transformer que 18 % à l'avoir fait. Là encore, les entreprises identifiées les données issues de ses bases de données pour répondre à comme les plus matures se distinguent, bien que moins de ses propres enjeux métiers ou objectifs, le capital data ne peut la moitié de cette catégorie ait déployé un tel plan, soit 46 % pas circuler dans l’entreprise, ce qui explique une absence de précisément. Un pourcentage qui tombe à 5 % chez les moins vision unifiée. Raison pour laquelle les outils et technologies matures. Big data sont encore peu adoptés. Pour ce qui est du retour sur investissement en particulier, à En effet, ces solutions ne prennent leur pleine mesure qu’en ce jour, 58 % des entreprises interrogées n’ont pas cherché à exploitant les informations provenant de tous les systèmes quantifier la contribution des solutions à la performance de informatiques et des directions de l’entreprise. leur entreprise. Là encore, l’écart est énorme entre les plus matures (77 %) et les « non matures » (3 %). * ROI : Return on Investment ** KPI : Key Performance Indicator 22 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
Avez-vous cherché à quantifier la contribution des solutions Big data à votre performance ? 58 % 42 % Oui Non Entreprises interrogées ayant répondu « non » (58 % du panel) 73 % 58 % 51 % 19 % Non matures Peu matures Très matures Frein n° 8 - Un manque de sponsorship de la direction générale L'absence de mesure ROI de l'exploitation (Big) data, alliée à une conjoncture économique défavorable peuvent expliquer la prudence de la plupart des directions générales sur le sujet. La majorité des entreprises non matures considère la perception du top management comme un frein à une exploitation optimale des données au sein de leur entreprise, soit 57 % d’entre elles, contre seulement 11 % pour les plus matures. C’est en effet le management qui, par ses arbitrages en matière de définition des axes stratégiques et d’investissement, va ou non permettre les transformations internes requises pour doter l’entreprise des moyens analytiques adéquats. Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 23
Vie privée et sécurité : des enjeux encore sous-estimés Frein n° 9 - La réticence à partager des données personnelles, un risque majeur pour la fiabilité de la data Avec l’avènement de l’économie numérique et l’explosion La protection des données personnelles cristallise aujourd’hui de l’Internet des objets, les data connaissent une croissance les réticences liées à l’exploitation des données clients. exponentielle et forment une masse gigantesque de données Or la confiance des clients, partenaires et citoyens dans une structurées et non structurées. marque, est une condition nécessaire à l’engagement dans la Et à la source de la production de ces données se trouve… marque et au partage non biaisé d’informations. l’individu. C’est pourquoi l’enjeu de la sécurité des données, * auquel s’ajoute celui de la protection de la vie privée, est la D’après une récente étude EY 70 % des consommateurs clé de l’avenir même du Big data. En effet, la protection des sont réticents à partager leurs données personnelles avec les données personnelles apparaît au centre des préoccupations entreprises et 49 % affirment qu’ils seront moins enclins à le des consommateurs, qui questionnent de plus en plus les faire dans les cinq années à venir. entreprises et responsables du traitement sur les garanties et la sécurité qu’ils mettent en place pour protéger les données personnelles qu'ils leur confient. Les questions les plus fréquemment posées sont relatives à la localisation de ces données, aux mesures de sécurité mises en place pour les protéger contre des accès non autorisés, à l’usage qui en est fait par le responsable de traitement, à qui elles sont destinées, etc. * "Ready for take-off? Overcoming the practical and legal difficulties in identifying and realizing the value of data", EY, 2014 24 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
Frein n° 10 - Faible sensibilisation aux enjeux Intégrer le cadre réglementaire de la de sécurité et de protection de la data protection des données : une nécessité Parmi les entreprises que nous avons interrogées, 30 % pour que sécurité juridique et confiance estiment ne pas être concernées par les enjeux de protection des clients constituent le socle du de la vie privée lors de l’exploitation de leurs données clients. développement Un résultat qu’il convient de nuancer selon le niveau de L’exploitation des données s’inscrit nécessairement maturité des entreprises en termes d’exploitation de data. dans un cadre réglementaire qui va protéger, outre En effet, les entreprises identifiées comme les plus matures les droits d’auteur, les créations originales et les dans l’Indice EY de Maturité Data sont 92,3 % à considérer investissements du producteur d’une base de données, que la question de la protection de la vie privée est un enjeu l’exploitation des données personnelles, c’est-à-dire qui prioritaire dans l’exploitation des données clients. Tandis que va permettre aux individus de connaître l’exploitation qui pour celles qui ont été identifiées comme non matures, seules est faite des données qui peuvent les identifier, et dans 20,7 % perçoivent la privacy comme un enjeu, contre 58,6 % certains cas, de s’y opposer. qui ne paraissent pas encore s’en préoccuper. Le cadre réglementaire de la protection des données Les données personnelles sont précieuses pour les personnelles en Europe impose notamment des ** obligations déclaratives auprès du régulateur national entreprises car elles revêtent un fort caractère prédictif . La confiance des producteurs de data augmentera fortement (la CNIL en France), des obligations de loyauté dans leur propension à partager des données personnelles fiables la collecte et la communication des données, des et précises, et baissera ainsi significativement les biais obligations d’information, d’accès et un droit d’opposition statistiques des modèles décisionnels et prédictifs. au bénéfice des personnes concernées, des restrictions en cas d’accès ou de transferts en dehors de l’Union Les entreprises sont généralement un peu plus sensibles européenne ainsi que des obligations d’effacement à l’aspect technique de la protection des données et, plus des données lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour précisément, au risque de cyberattaque de leurs systèmes répondre à la finalité qui a motivé leur collecte. d’information (SI). Ce cadre réglementaire n’a pas vocation à empêcher * Selon une étude internationale EY sur la sécurité des l’exploitation des données personnelles mais à donner systèmes d’information, 59 % des entreprises interrogées des garanties aux personnes dont les données sont considèrent que les menaces externes sur leurs systèmes traitées, en termes de sécurité des données et de d’information sont en progression et 43 % affirment que leur contrôle sur l’utilisation qui est faite de leurs données. budget sécurité des systèmes d’information est en hausse. La conformité avec ce cadre réglementaire répond, au-delà de la prévention du risque juridique de sanction pouvant être prononcé par le régulateur (jusqu’à 300 000 euros en droit positif, mais bientôt jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires mondial du responsable de traitement lorsque le projet de règlement en matière de protection des données sera adopté), à un enjeu éthique de respect de la vie privée des individus. Fabrice Naftalski ** “Under cyber attack - EY’s Global Information Security Survey 2013” Associé - Ernst & Young Société d'Avocats - Responsable EMEIA des activités Droit des Technologies de l'Information et de la Propriété Intellectuelle Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 25
III/ Déployer une stratégie (Big) data efficace : les leviers d'action 26 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
La révolution (Big) data n’a pas encore eu lieu Deux tiers des entreprises françaises (63 %) considèrent que Force est de constater qu’au-delà de l'effet de mode, le Big le Big data est un concept intéressant mais encore trop vague data représente pour beaucoup un concept flou, encore pour constituer un levier de croissance. difficile à appréhender au sein des entreprises, tant en termes de transformation organisationnelle, de stratégie, de ROI que de gestion et de formation des compétences. En témoigne le « Le Big data est un concept intéressant mais encore passage au filtre de l’Indice de Maturité Data : imprécis qui ne constituera un levier de croissance que pour certaines entreprises » Peu d’études d’opportunité (Big) data sont 63 % menées Les entreprises les plus matures sont celles qui ont non 37 % seulement lancé une étude d’opportunité du Big data – ce qui ne représente que 9 % du nombre total d’entreprises composant notre panel - mais aussi celles qui ont mis en place une stratégie globale de gestion de leurs données clients, pour favoriser une meilleure circulation des données en Non Oui interne et une exploitation plus cohérente et transversale de ces données. Entreprises interrogées ayant répondu « oui » Pour l’heure, la moitié des entreprises n’a pas étudié les (63 % du panel) opportunités éventuelles liées au Big data. 72 % « Notre entreprise a étudié les opportunités éventuelles 63 % 61 % liées au Big data » 35 % Oui, étude en cours Oui, plan Big data déployé 23 % 18 % 2 % Oui, Non matures Peu matures Très matures mais nous avons conclu à l’absence d’opportunité 57 % La deuxième révolution de la (Big) data sera celle Non de l'exploitation des données non structurées et de l'open data. Bruno Perrin Associé - Ernst & Young et Associés Responsable du secteur Technologies, Médias, Télécoms en France Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 27
L’entreprise n’a pas de vision 360° de la data Il n’existe pas encore de « gouvernance data » La moitié des entreprises interrogées reconnaît que Les entreprises hésitent encore sur l’entité qui doit prendre l’absence « d’un plan d’action clair qui constitue une feuille la responsabilité de la stratégie data, tout autant que sur les de route pour l’ensemble de l’entreprise » est un frein à une modalités d’application. En effet, selon le niveau de maturité exploitation optimale des données clients. des entreprises, il incombe soit à la direction marketing Le pourcentage s’élève à 76 % pour les entreprises « pas du (pour les plus matures) soit à la DSI d’impulser et/ou de tout matures » contre 35 % chez les « très matures ». Un état mettre en place la stratégie data, mais aussi de concentrer de fait à rapprocher de la position du top management sur les compétences data de l’entreprise. En effet, pour 58 % le sujet du Big data, à savoir s’il juge utile ou non d’améliorer des entreprises très matures, les compétences en gestion significativement la gestion actuelle des données clients. de données de l’entreprise sont rattachées à la direction marketing et pour 31 % des entreprises pas du tout matures, 57 % des entreprises non matures considèrent la perception les compétences en gestion de données de l’entreprise sont du top management comme un frein versus 11 % pour les très rattachées à la direction technique. matures. Quoi qu’il en soit, la prise en main par une seule direction fonctionnelle induit le risque que l'exploitation des données clients de l’entreprise soit limitée ou orientée prioritairement aux besoins de la direction fonctionnelle concernée. Outre-Atlantique, on voit émerger une fonction de Chief Data Officer qui a la charge de l’ensemble des questions relatives à la stratégie data de l’entreprise. Même au sein des entreprises les plus matures de notre panel, cette réflexion est à peine entamée et ne s'est pas traduite en actions concrètes. 28 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
Stratégie (Big) data : deux approches coexistent actuellement Parmi les entreprises interrogées pour notre étude et celles b) Le modèle « Top-down » auprès desquelles nos sommes intervenus récemment, Ce modèle repose sur la définition d’une stratégie Big data nous observons deux tendances principales en matière et d’une feuille de route avec des offres allant jusqu’à la d’élaboration d’une stratégie de données clients : le modèle monétisation de la data, des pistes pour mieux exploiter Bottom-up et le modèle Top-down. les data internes ainsi qu’un programme d’enrichissement a) Le modèle « Bottom-up » externe du patrimoine data de l’entreprise. Son objectif est double : lancer des projets au niveau Dans ce cas, conscient de l’effet Big data et convaincu de la opérationnel afin de valider les avancées et les bénéfices valeur future, le management soutient la démarche et insuffle potentiels à en tirer, sachant que les projets sont issus de une transversalité, incitant les métiers à travailler ensemble l’analyse du champ des possibilités offertes par le Big data. sur la data. Ce modèle « test & learn » a un triple avantage : des résultats Revers de la démarche « (Big) data-oriented » : des délais de d’impacts concrets sur la société, un effet d’apprentissage sur mise en place et de retours sur investissements relativement les équipes et le lancement de plusieurs projets en parallèle. longs. Dans une telle démarche, il se peut qu’il n’y ait toujours Il a cependant ses limites. L’absence d’indicateurs de pas d’actions enclenchées quelques mois après le lancement performance peinera à convaincre le management de l’effet du projet. Par ailleurs, les potentiels (phase « PoV » ) Big data et de l’utilité du projet. Ce à quoi s’ajoutent l’absence identifiés peuvent être tellement nombreux qu’il n’est pas aisé de fil conducteur commun, qui entraîne une dispersion des d’anticiper et d’arbitrer parmi les projets data à lancer • En savoir plus p. 31 projets, un manque de regard externe sur les projets, et (PoC). un défaut d’investissement et de moyens qui limitent les possibilités. Dans cette approche, les entreprises sont équipées d’outils spécifiques, en particulier de data visualisation. Elles cherchent à répondre à des problématiques spécifiques (ex. : en mode agile) mais ne disposent pas forcément de l’architecture permettant le temps réel et les problèmes liés au silotage demeurent la plupart du temps. Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 29
Le succès du projet data chez Prisma a reposé sur la réunion inédite de l’ensemble des métiers et expertises au sein du groupe. Yoann Denée Directeur, Prisma Digital Facteurs clés de succès du déploiement d’une stratégie (Big) data Si chacune des approches data mises en place dans les entreprises a des avantages, selon nous, ce n‘est pas tant l’approche en tant que telle qui fera la différence, mais la prise en compte d’un certain nombre de conditions qui constituent les facteurs clés de succès d’une stratégie (Big) data. L’entreprise se doit de définir une stratégie (Big) data, avec la data comme axe stratégique de l’entreprise au même titre que la politique tarifaire par exemple. Les 5 facteurs clés de succès du déploiement d’une stratégie (Big) data : • Facteur clé de succès n° 1 - Une transversalité indispensable en amont Au-delà de la gestion des volumes, l’un des plus forts attraits S’il intègre l’ensemble des métiers de l’entreprise le plus en des nouvelles technologies en matière d’exploitation et amont possible, le projet stratégique (Big) data permettra d’analyse statistique des données clients réside dans la d’effectuer le recensement le plus exhaustif afin de révéler capacité à s’adapter très aisément à la diversité des données : des corrélations et d’en tirer des enseignements inédits. variété des sources, hétérogénéité des formats, etc. À cette transversalité inter-directions s’ajoute une nécessaire Dès lors, l’un des premiers enjeux dans le déploiement d’une pluridisciplinarité. La connaissance et la maîtrise des enjeux stratégie (Big) data consiste à mobiliser l’ensemble des liées à l’exploitation des données tout au long de la chaîne directions qui disposent souvent de points de vue divers et de valeur relève en effet de profils très différents. Afin de complémentaires en matière de connaissance d’un client. prendre en compte l’ensemble de ces dimensions, une équipe- Les occasions de collecter des données sur un client sont projet devra rassembler des profils d’informaticiens, de chefs multiples et relèvent généralement de la responsabilité d’une de produits marketing, de financiers, d’analystes statisticiens, multitude de directions métiers ou fonctionnelles d’une de juristes... entreprise. Des rigidités organisationnelles, doublées de freins Une gestion de projet performance devra enfin être techniques, freinent souvent l’exploitation de cette manne de idéalement mise en place afin de coordonner les travaux connaissance que les croisements et mises en corrélation de de ces équipes et garantir l’avancée des travaux et solliciter toutes les données pourraient révéler. occasionnellement des arbitrages lorsque des points de blocage se feraient jour. 30 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
Le réseau permet de faire évoluer en direct et avec le plus vaste public les initiatives et les services. C'est une révolution qui accélère tous les cycles et fait de l'erreur initiale une étape naturelle du succès futur. Pierre Bellanger Fondateur et président-directeur général du groupe Skyrock • Facteur clé de succès n° 2 - Une implication • Facteur clé de succès n° 3 - La mise en place forte de la direction générale d'un Agile Analytics Program Un programme de travail transverse mêlant des compétences et des entités aussi variées doit être porté par une implication Un cadrage stratégique des enjeux et opportunités forte, au niveau du comité exécutif ou d’une entité ayant déjà pour vocation de travailler en support de multiples entités Il faut consacrer un temps significatif à la qualification des métiers (direction de l’innovation, direction de la stratégie…). besoins et enjeux de l’entreprise et à son diagnostic maturité, Un soutien qui garantit une meilleure adhésion, une visibilité et ensuite seulement choisir les technologies les plus à même plus forte et évite que le projet ne soit restreint qu’à l’atteinte de répondre aux besoins identifiés et qualifiés. d’objectifs spécifiques de l’entreprise (développement des C’est à ce moment seulement que le socle technologique doit ventes, réduction des coûts…). Si de ce projet découlent des être spécifié. opportunités de modifications organisationnelles, qui entrent généralement dans le périmètre de la direction générale, Les PoV* comme point d'ancrage l’implication de cette dernière dès la genèse du projet permettra d’accélérer la compréhension des enjeux et des Sur le sujet de la data, il est indispensable de travailler bénéfices attendus en vue d’éventuels arbitrages. avec les utilisateurs finaux, au plus près des décideurs, et de se lancer au travers de projets concrets, via des pilotes, * autrement appelés PoC (proof of concept ). * PoV : des PoC (proofs of concept) associés à des études d'impact pour évaluer Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 31
Avant tout, il convient de définir les opportunités business Une feuille de route agile et un plan d’actions concret (phase PoV*) puis de sélectionner, dans ce champ des possibles, les projets qui répondent le mieux aux deux La feuille de route à moyen terme (3 à 5 ans) doit définir des critères suivants : facilité de mise en œuvre et gain maximal actions prioritaires concrètes, des objectifs à court et moyen pour l’entreprise (ROI) ; l’intérêt de cette démarche étant termes, et des KPI associés à chacune des actions. d’autofinancer l’industrialisation du projet (sa généralisation à Le développement des PoC doit se faire selon un mode de l’ensemble de l’entreprise) et la mise en place d’une stratégie co-construction agile. Big data. Il est important que les décideurs et utilisateurs finaux puissent utiliser eux-mêmes (et interagir avec) les résultats qui leur sont remontés (reporting). Ils ne se satisfont plus de * PoV : des PoC (proofs of concept) associés à des études d'impact pour rapports figés. évaluer leur rentabilité (ROI) Il est important de chercher à développer des La réflexion stratégique de Renault en matière initiatives variées permettant d’acquérir de la d’exploitation des données s’est d’abord appuyée sur connaissance sur un large panel de technologies Big un recensement exhaustif des sources de données data innovantes (text mining, extraction de data en clients (outils CRM, concessionnaires, web et & réseaux grandes dimensions...). sociaux, open data [incidentologie], etc.) et sur Éric Martin l’évaluation de leur valeur potentielle pour le Groupe à Responsable technique Big data chez Air France court et moyen termes. Patrick Hoffstetter Directeur Digital Factory chez Renault 32 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
• Facteur clé de succès n° 4 - La confiance by design La protection juridique et technique des données répond au triple enjeu de fiabilité, d'efficacité et de réputation. Les entreprises doivent donc prendre en compte, en amont de tout projet Big data, les enjeux de risques techniques, juridiques et réputationnels. Les directions informatiques et juridiques en particulier doivent créer ensemble les conditions du partage non biaisé d'informations clés, notamment de données à caractère personnel, pour la pertinence des modèles prédictifs. La sécurisation des données et de leur utilisation est aussi un prérequis pour valoriser les données à caractère personnel. Garantir la sécurité et l'intégrité des données traitées, la protection des données personnelles, tout en étant transparent sur l'utilisation de ces données répond à l'enjeu de réputation de l'entreprise à l'ère digitale. Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 33
Exploitation (Big) data : des freins aux leviers d'action Les freins identifiés Collecte de la data limitée aux canaux et données traditionnels FREIN 1 Analyse de la data - les données collectées sous-exploitées FREIN 2 Manque de compétences analytiques FREIN 3 FREIN 4 Carence des outils de traitement de la data non structurée Analyse de la data (trop) peu orientée vers le temps réel et le prédictif FREIN 5 Absence de mesure du ROI des opportunités (Big) data FREIN 6 Faible transversalité dans la gestion des projets (Big) data FREIN 7 Manque d'implication de la direction générale FREIN 8 Réticence des clients, partenaires et citoyens à partager leurs données personnelles FREIN 9 Faible sensibilisation aux enjeux de sécurité et de protection de la data FREIN 10 34 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
Les leviers d'action • Évaluer le patrimoine data de l'entreprise • Qualifier les besoins et enjeux de l'entreprise • Recruter des profils de type data scientist • Privilégier une approche par étape en adoptant des plateformes fiables et largement utilisées (ex. : outils et plateformes ouvertes telles que Hadoop ou R) • Identifier les corrélations entre les data internes et externes à l'entreprise • Identifier les process de calcul clés et mettre en place des algorithmes spécifiques Big data pour paralléliser les temps de calcul Agile analytics program • Développer conjointement des pilotes (PoC) avec les opérationnels pour fiabiliser ces projets et baisser significativement leur temps de développement • Prioriser les développements des PoC via un cadrage stratégique des enjeux et opportunités identifiés • Diffuser la culture data en interne via une double impulsion top-down et bottom-up • Mettre les collaborateurs/experts sur des arbitrages complexes nécessitant une forte expertise et favoriser ainsi les gains de productivité et l'innovation La confiance by design • Prise en compte en amont des risques techniques, juridiques et réputationnels • Prise en compte de la réglementation et des bonnes pratiques en amont de tout projet Big data • Transparence sur l'utilisation de la data, a fortiori la data personnelle Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 35
Études de cas 36 |
Étude de cas n° 1 Lancement d'une série de projets "proofs of value" ayant pour objectif d'accélérer le time to market pour les nouveaux produits Secteur Accompagnement EY Distribution et Produits de Grande Consommation EY a travaillé avec différentes directions du groupe : • Métiers (Développement des nouveaux produits, Sécurité, Gestion, Pré-industrialisation, Évaluation in vitro…) afin Problématique client d’anticiper les besoins des utilisateurs finaux (B2B) Besoin de compétences métiers et techniques pour • DSI sur la définition de l’architecture de la plateforme accompagner la mise en place d’un service de conception notamment : assistée et du développement des opportunités retenues pour - Choix des briques logicielles en particulier Open Source les acteurs de l’entité recherche d’un groupe international de - Choix et installation de la base Hadoop et de son éco- produits de grande distribution système - Mise en place d’une solution de stockage dans le Cloud alimentant, via une liaison sécurisée, une base Hadoop Contact EY interne David Naïm - Anticipation de l’intégration des flux issus des Associé, Ernst & Young Advisory instruments connectés Responsable du pôle Stratégie, Marketing et Innovation - Préparation de l’industrialisation des proofs of concepts [email protected] (PoC) développés et validés (Sandbox) - Connexion aux bases de données de l’entreprise • DAF sur l’évaluation la valeur attendue et le ROI des proofs of value (PoV) EY a ainsi contribué au développement des PoC de plusieurs opportunités de valeur (PoV). Valeur ajoutée pour le client Mise en œuvre de plusieurs proofs of value (PoV) ayant démontré une forte valeur ajoutée : • Très forte réduction du temps de développement des nouveaux produits et donc du Time to Market • Par l’exploitation de l’historique de résultats d’essais de l’entité et la mise en place d’une méthodologie d’essais virtuels, les experts de la sécurité produits peuvent éviter la commande d’essais longs et bloquants : le temps de développement du produit est diminué de plus de 6 semaines ! Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 37
Étude de cas n° 2 Valorisation du patrimoine data de l'entreprise Secteur Accompagnement EY Technologies, Médias, Télécoms • Construction d’une stratégie et d’un plan d’action data pour optimiser et valoriser l’actif data Problématique client • Recommandations sur l’organisation et la gouvernance pour une exploitation transverse de la data Meilleure connaissance de ses clients et de ses publics dans le • Recommandations sur les marchés porteurs, cadre de la transformation digitale du groupe les segmentations de marché et les innovations en termes d’offre de services Contact EY • Support aux équipes marketing et ventes Vincent Placer Directeur exécutif, Ernst & Young Advisory Stratégie Marketing Innovation - Business Analytics [email protected] Valeur ajoutée pour le client • Construction d’une vision client unifiée • Définition des axes de valorisation du patrimoine data et des priorités • Identification du portefeuille de projets et proofs of value à lancer 38 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
Étude de cas n° 3 Lancement et animation d'un programme global "Agile Analytics" Secteur Accompagnement EY Sciences de la vie • Mise en place du projet en partenariat avec notre client • Nous avons effectué un diagnostic maturité data du client Problématique client et défini un portefeuille de 45 projets valorisés (PoV*) impliquant différents métiers de l’entreprise (finance, client, Incapacité à exploiter pleinement la multitude de ses ressources humaines, fiscalité, supply chain, audit interne, données (données expérimentales, données sur l’activité de etc.) distribution des médicaments dans le monde, données clients, • Chaque projet a été le fruit d’une consultation en interne, données des professionnels de santé, etc.) d’entretiens métiers et de groupes de travail impliquant l'ensemble des directions opérationnelles, à différents Contact EY échelons Karim Ben Djemiaa • L'avancée de chaque projet a été supervisée par un chef de Directeur exécutif, Ernst & Young Advisory projet unique garant de la tenue des délais Stratégie, Marketing et Innovation - Data Analytics [email protected] Valeur ajoutée pour le client • Identification d'opportunités métiers à hauteur de plusieurs centaines de millions d’euros à horizon 3 à 5 ans • 30 millions d’euros de gains dès la première année • Ébauche d'une nouvelle organisation de l'entreprise autour de la data • Gains de productivité pour les équipes de notre client * Les PoV sont des PoC (proofs of concept) associés à des études d'impact pour évaluer leur ROI Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 39
Étude de cas n° 4 Garantir le même niveau de protection des données personnelles quelle que soit leur localisation géographique Secteur Accompagnement EY Services aux entreprises • Rédaction et obtention des premières BCR* "data processor" approuvées en Europe dans le cadre de la Problématique client procédure de reconnaissance mutuelle avec la CNIL comme chef de file (et les autorités espagnoles et allemandes en • Manque de confiance de ses partenaires/clients co-instructeurs) • Les données RH et paie de ses clients sont pour partie traitées en dehors de l’UE (Tunisie, Maroc et à terme Inde), ce qui dissuadait les sociétés européennes de lui confier la * BCR : Binding Corporate Rules paie ou la gestion RH de ses clients Contact EY Fabrice Naftalski Associé, Ernst & Young Société d'Avocats Responsable EMEIA des activités Droit des Technologies de l'information [email protected] Valeur ajoutée pour le client • Garantir le même niveau de sécurité juridique quelle • Avantage par rapport à ses concurrents que soit la localisation des données personnelles internationaux dont une partie des activités sont traitées pour le compte de ses clients (i.e. assurer au pilotées hors d’Europe client que ses données bénéficient du même niveau de protection juridique que celui prévu par la directive • Confiance accrue de la part de ses clients européens européenne en matière de protection des données) • Conformité des traitements de données paie à l'international 40 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
Étude de cas n° 5 Sécurisation juridique du lancement et du déploiement de services Big data Secteur Accompagnement EY Technologies, Médias, Télécoms • Sécurisation du service dans sa protection juridique • Sécurisation du déploiement du service (protection de la vie Problématique client privée, droit du travail…) Sécurisation et conformité d’un nouveau service de • Analyse des modes de protection disponibles en France croisement de certaines données RH de ses clients avec des pour ce nouveau service et des méthodes et/ou moyens mis données publiques disponibles sur internet (ex. : réseaux en œuvre à cet effet sociaux, blogs, sites internet personnels, politiques ou • Sécurisation juridique des conditions de présentation syndicaux, etc.) et de lancement de ce service Contact EY Fabrice Naftalski Associé, Ernst & Young Société d'Avocats Responsable EMEIA des activités Droit des Technologies de l'information [email protected] Valeur ajoutée pour le client • Sécuriser le lancement et le déploiement de services autour de Big data • Pérenniser la position de leadership du client • Optimiser la protection des actifs incorporels du client (propriété intellectuelle, savoir-faire...) Quelle maturité dans l'exploitation des données clients ? | 41
Note méthodologique Pourquoi avoir centré notre analyse sur les données clients ? Nous avons mené une enquête terrain auprès de 152 Parmi la quantité de données disponibles, les données entreprises françaises, avec des effectifs compris entre 500 clients sont celles qui sont, selon nous, directement liées à et 2 000 personnes, sur la base d’un questionnaire administré la croissance du chiffre d’affaires et au développement de par téléphone auprès de directeurs généraux, marketing, l’activité. Ce sont elles qui disposent, à moyen terme, du plus systèmes d'informations, financiers, relation clients et CRM. gros potentiel en termes d’amélioration de la performance Ces entreprises appartiennent à 5 secteurs d’activité : TMT commerciale des entreprises et de leur diversification vers de (Technologies, Médias, Télécoms), Distribution et produits de nouveaux métiers ou marchés. Ce qui ne signifie pas que les grande consommation, Transport et Automobile, Services données autres, telles que la consommation énergétique des financiers, Santé. bâtiments, ne puissent pas être source de profitabilité non négligeable. En parallèle de cette enquête quantitative, 12 entretiens qualitatifs ont été conduits auprès d’entreprises appartenant Abréviations aux secteurs couverts. En outre, nous avons construit notre Indice EY de Maturité Data sur la base de 10 variables auxquelles nous avons CAPEX Capital Expenditure affecté une note allant de –2 à +2 pour chaque entreprise KPI Key Performance Indicator de notre panel. Les scores permettent de capturer le degré d’avancement OPEX Operating Expenditure effectif sur chacune des variables. L’ensemble des notes PoC Proof of concept. L'expression désigne des projets obtenues par entreprise a été additionné pour en tirer pilotes déployés rapidement pour démontrer la 3 groupes statistiques qui traduisent le niveau global de faisabilité d'une opportunité maturité de chaque entreprise. PoV Proof of value. L'expression désigne des projets pilotes (PoC) auxquels sont associées des études d'impact pour évaluer leur rentabilité avec leur Construction de l'Indice EY de Maturité Data généralisation (phase d'industrialisation) L’indice de maturité agrège les réponses à 10 questions ROI Return on Investment factuelles portant sur l'état des lieux de la collecte et de l'analyse de la data (volume, diversité, profil, etc.), la gouvernance et l'implication des métiers, la finalité des modèles analytiques et la prise en compte des enjeux de sécurisation de la data. L’ensemble des modalités de réponses a été codé avec une échelle centrée allant de -2 à 2 en fonction du niveau de maturité estimé par les experts EY. Les réponses de chaque répondant ont ainsi permis de donner une note brute allant de -20 à 20. Les entreprises dont la note est négative ont été qualifiées de non matures, celles dont les notes allait de 0 à 9 ont été qualifiées de peu matures, et celles obtenant plus de 10 points ont été qualifiées de très matures. 42 | (Big) data : où en sont les entreprises françaises ?
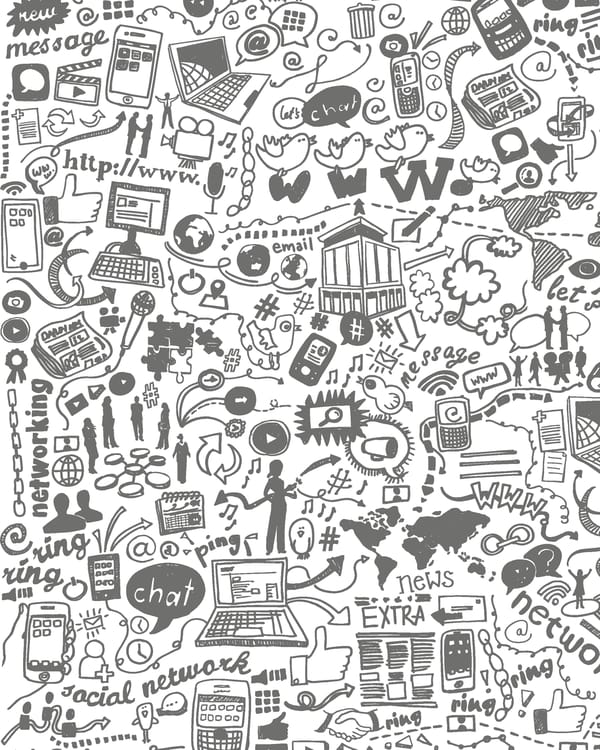
EY | Audit | Conseil | Fiscalité & Droit | Transactions EY est un des leaders mondiaux de l’audit, du conseil, de la fiscalité et Contacts du droit, des transactions. Partout dans le monde, notre expertise et la qualité de nos services contribuent à créer les conditions de la confiance David Naïm dans l’économie et les marchés financiers. Nous faisons grandir les talents Associé, Ernst & Young Advisory afin qu’ensemble, ils accompagnent les organisations vers une croissance Responsable du pôle Stratégie, Marketing et Innovation pérenne. C’est ainsi que nous jouons un rôle actif dans la construction d’un Tél. : + 33 1 46 93 59 58 monde plus juste et plus équilibré pour nos équipes, nos clients et la société E-mail : [email protected] dans son ensemble. EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou plusieurs Bruno Perrin des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun est une entité Associé, Ernst & Young et Associés juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, société britannique à Responsable du secteur Technologies, Médias, Télécoms en France responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Tél. : + 33 1 46 93 65 43 Retrouvez plus d’informations sur notre organisation sur www.ey.com. E-mail : [email protected] © 2014 Ernst & Young Advisory Fabrice Naftalski Tous droits réservés. Associé, Ernst & Young Société d’Avocats Tél. : + 33 1 55 61 10 05 Studio EY France - 1407SG049 E-mail : [email protected] SCORE France N° 14-057 Vincent Placer Photos : © Fotolia - © EY Directeur Associé, Ernst & Young Advisory Tél. : + 33 1 46 93 61 32 Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte E-mail : [email protected] sur l’environnement. Cette publication a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil Louisa Melbouci professionnel en matière comptable, fiscale ou autre. Pour toute question spécifique, Responsable Marketing Technologies, Médias, Télécoms en France vous devez vous adresser à vos conseillers. Tél. : + 33 1 46 93 76 47 ey.com/fr E-mail : [email protected] Cette étude a été réalisée par EY, sous la direction de Vincent Placer, avec la participation de Pascal Antonini, Jeff Chau, Stéphane Médard, Louisa Melbouci, Franck Rimek, Aurèle Tabuchi, Pierrick Vaudour, France de Roquemaurel à la rédaction et Sandrine da Cunha au graphisme.
